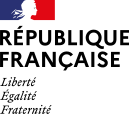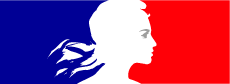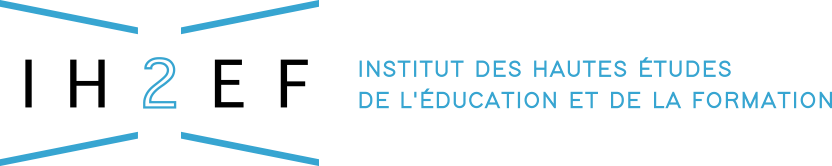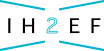Guillaume Jacq
Docteur en sciences de l’éducation et de la formation, chercheur-associé au laboratoire EMA de CY Cergy Paris université et inspecteur de l’Éducation nationale second degré.
Socio-historien de l’éducation, son travail se concentre sur le lycée professionnel et tout particulièrement sur la construction identitaire des professeurs qui y enseignent. Il travaille sur les stratégies déployées par les professeurs de lycée professionnel pour accompagner les élèves avec lesquels ils entretiennent une relation singulière. Avec les troisièmes à dispositifs particuliers, ses questions de recherche portent actuellement sur les pédagogies de l’alternance et les représentations des enseignants de la notion de liberté pédagogique.

Une dualité plurielle
Les professeurs de lycée professionnel (PLP) comme la voie professionnelle souffrent d’une image "à la fois imprécise et inquiétante" (Rey & Buisson-Fenet, 2016).
Imprécise car les enseignants dispensent des disciplines non académiques et bivalentes. L’enseignement consistant à faire acquérir des compétences professionnelles donne une image qui semble brouillée car insécables en savoirs didactiques.
Inquiétante car le lycée professionnel (LP) est perçu comme le lieu d’accueil d’un public scolaire en rupture avec l’école ou ayant échoué dans les filières générales.
Y enseigner en LP induirait d’exercer un métier différent que celui du collège ou des filières générales.
La genèse d’un corps hors "normes"
Le corps des PLP se distingue historiquement des autres corps enseignants par les mécanismes qui ont provoqué sa mutation puisqu’il est un des seuls à s’être "renouvel(é) de manière radicale à la suite des changements de normes de recrutement" (Tanguy, 1991, p. 14).
La création du baccalauréat professionnel en 1984 s’est accompagnée d’un choix politique d’uniformiser le corps enseignant qui réunissait jusqu’alors une pluralité de statuts. Le corps des PLP a donc été créé, subdivisé en deux grades : le PLP 1er grade ouvert aux titulaires d’un DEUG permettant d’enseigner auprès des classes de CAP et de BEP et le PLP 2e grade réservé aux titulaires d’une licence permettant d’enseigner dans les classes de baccalauréat professionnel. La logique d’uniformisation s’est poursuivie, aboutissant à la disparition progressive des PLP 1 à partir de 1989 intégrés au deuxième grade.
Les généraux et les pro
À l’image de la dualité de la voie professionnelle entre le monde économique et le monde scolaire, le corps des PLP se caractérise également par une distinction entre les enseignants du domaine professionnel et ceux des disciplines générales.
Les premiers, anciens ouvriers qualifiés, ont été progressivement remplacés par de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. La culture de l’usine a cédé sa place à celle des techniciens provoquant la transformation du modèle d’enseignement du métier "fondé sur un corpus de savoirs délimités au profit d’un enseignement technique fondé sur un ensemble de démarches […] permettant une adaptation progressive à diverses activités professionnelles" (Tanguy, 1991, p.149). La transposition de leur conception du métier et de leur rapport aux savoirs a modifié l’approche de l’enseignement en vigueur jusqu’alors.
Les seconds, les enseignants de matières générales au LP, se composent principalement de trois groupes définis par leur bivalence héritée des anciens professeurs d'enseignement général de collège (PEGC). Cette bi-disciplinaire, "constitutive de leur identité", leur confère un positionnement singulier au sein des enseignants du second degré en "les différenciant des certifiés et les rapprochant des professeurs des écoles" (Rapport de l’Inspection générale n° 2012-070, juillet 2012, p 36).
Une entrée dans le métier plus incertaine
Ces enseignants peuvent être définis pour certains par leur rapport contrarié au métier (Jellab, 2005) car le choix de devenir PLP s’est souvent fait par défaut suite à des échecs aux autres concours (CAPES, CAPET ou agrégation). Parfois contrariée, leur entrée dans le métier est surtout incertaine (Jacq, 2022). Ne connaissant que peu le LP, ils sont ainsi dans l’obligation de redéfinir leurs modalités d’enseignement dans un délai très court. À ce titre, l’année de stage ainsi que les temps de formation jouent un rôle capital dans la structuration de leur identité professionnelle (Jacq, 2023).
Bien que différents, les PLP et leurs élèves entretiennent une relation singulière : tous deux découvrent une voie de formation inconnue, des modalités d’enseignement différentes et de nouveaux lieux de formation. Finalement les professeurs et les élèves s'allient dans ce nouvel environnement que les uns et les autres n’ont pas choisi.
Un lien particulier avec les élèves
Pour les PLP, cette homologie de condition avec leurs élèves se traduit par une nécessaire redéfinition de leurs missions.
Un principe de réalité
Les élèves ont intégré les mécanismes les ayant orientés en lycée professionnel (Palheta, 2012). Cette position incorporée provoque un renforcement du repli sur soi dans un univers cloisonné qui "leur assure une forme de protection contre le milieu des "vrais" lycéens, des lycéens "légitimes” (Beaud, 2003, p. 99).
Dans ce contexte, la relation entre les élèves et les professeurs est inévitablement impactée par ce processus. Que ce soient les élèves ou les professeurs, ils ont pleinement conscience que les procédures d’orientation, les difficultés cumulées (sociales, économiques, scolaires) conduisant à suivre un parcours de formation en LP amènent à différer le moment où le cursus sera terminé. Dans ce contexte, le professeur doit assumer les conséquences de ce processus et donc trouver une modalité pour retarder le plus possible son issue excluante.
Une nécessaire complicité
Dans cette perspective, les PLP ont recours à une autre pédagogie. Les savoirs experts cèdent leur place aux compétences relationnelles. Alors que dans les autres voies scolaires, le relationnel peut être perçu comme ambivalent (Le Floch, 2008), il prend une autre dimension en LP. Cette compétence distingue un peu plus le métier de PLP de celui des autres enseignants pour qui le renoncement de leurs disciplines de formation au profit du relationnel peut être perçu comme un véritable drame (Barrère, 2003). Cette relation élèves/professeur puise ses origines dans l’héritage légué par les PEGC notamment dans les contenus de formation des écoles normales nationales d'apprentissage (ENNA) (Bret, 2015) qui ont été le creuset de ceux des PLP.
Mais, au fil des années, les enseignants des domaines professionnels, qui incarnaient l’excellence pour un certain nombre d’élèves, ont été confrontés à un nouveau public peu enclin à s’investir dans le monde professionnel comme ceux des disciplines générales, à des élèves rencontrant de nouvelles difficultés d’apprentissage. Les PLP ont donc été dans l’obligation de créer de nouvelles stratégies pédagogiques.
L’innovation au cœur des pratiques
L’analyse des pratiques pédagogiques mises en œuvre dans les lycées professionnels permet de dévoiler des démarches spécifiques.
Des démarches explicites
La valorisation des élèves, l’enseignement du concret et une finalité utilitariste des apprentissages caractérisent leurs projets pédagogiques. Cela passe également par la justification des démarches retenues par les professeurs pour amener les élèves vers les apprentissages. Cette conception explicite permet de renforcer le lien de confiance qui se construit entre le professeur et ses élèves. Les PLP développent ainsi régulièrement des stratégies de contournement pour amener les apprentissages aux élèves (et non l’inverse) par des démarches ludiques par exemple. Il y a ici une spécificité pédagogique construite par la mutualisation et l’expérience au sein du corps enseignant. L’autonomie relative dont disposent les PLP, notamment vis-à-vis des injonctions ministérielles, leur a permis "d’innover et inventer de nouvelles pratiques pédagogiques en vue de former des élèves souvent réfractaires à la forme scolaire" (Jellab, 2017, p. 132).
Une co-construction des apprentissages
Les PLP construisent les modalités d’accompagnement de ces jeunes en composant avec de nombreux facteurs : la diversité de leurs profils, le contexte d’enseignement, la spécificité de la filière et "l’air du temps" (Perrot, 1987). Cette dernière composante définie comme la faculté d’adaptation aux évolutions sociétales conforte l’idée que l’innovation passe par une forme d’improvisation définie comme "une adaptation doublée d’une invention" (Azéma, 2019, p. 28). Contrairement à l’idée d’une forme d’amateurisme ou d’incompétence, cette improvisation est avant tout un processus relevant d’un acte collectif. C’est par une interaction spécifique entre le professeur et les élèves que les apprentissages peuvent se réaliser.
Conclusion
L’identité des PLP est plurielle et nécessite de dépasser le simple clivage disciplines générales/matières professionnelles. Comme tout processus social, cette identité se construit par des étapes institutionnellement ritualisées (concours orchestré par des jurys nationaux, année de stage validée par les instances académiques, intégration au sein d’un établissement ou temps de formations initiales ou continues). Dans ce contexte, les interactions avec les élèves mais également avec les différents agents de l’Éducation nationale (chef d’établissement, inspecteur, équipe pédagogique ou disciplinaire, etc.) contribuent à la construction progressive de l’identité d’un corps enseignant au sein duquel chaque PLP possède sa grille de lecture, ses critères et ses caractéristiques propres.
Bibliographie
- Barrère, A. (2003). Les enseignants au travail : Routines incertaines ;
- Beaud, S. (2003). 80% au bac et après? Les enfants de la démocratisation scolaire. Éd. la Découverte ;
- Bret, D. (2015). Des maîtres de CEG aux PEGC (1961-1986) : Identité primaire et/ou secondaire ? Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, 48(3), 59‑81 ;
- Jacq, G. (2022). Analyse socio-historique de l’identité professionnelle de professeurs bivalents, les PLP Lettres-histoire. Entre relégation et résistance, un statut à la lisière du champ scolaire. [Thèse]. Lyon 2 Lumière ;
- Jacq, G. (2023). La formation, le territoire de l’affirmation de l’identité des Lettres-histoire. Interpares revue électronique de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales, 10, 27‑35 ;
- Jellab, A. (2005). Les "nouveaux enseignants" de lycée professionnel : Un rapport "contrarié" au métier ? L’Homme et la société, 156‑157(2), 147 ;
- Jellab, A. (2017). La professionnalisation des enseignants du secondaire en France. Entre injonctions institutionnelles et approche sociologique. Éducation et socialisation, 46 ;
- Le Floch, M.-C. (2008). Une relecture du sale boulot. Entre une division morale et une division sociale du travail éducatif. Pensée plurielle, 18(2), 31‑48 ;
- Noiriel, G. (2006). Introduction à la socio-histoire. la Découverte ;
- Palheta, U. (2012). La domination scolaire : Sociologie de l’enseignement professionnel et de son public. Presses Univ. de France ;
- Perrot, M. (1987). L’air du temps. In M. Agulhon & P. Nora (Éds.), Essais d’ego-histoire. Gallimard ;
- Rey, O., & Buisson-Fenet, H.(2016) (dir.), Le lycée professionnel : relégué et avant- gardiste ?. Lyon : ENS Éditions, coll. "Entretiens Ferdinand Buisson" ;
- Tanguy, L. (1991). L’enseignement professionnel en France : Des ouvriers aux techniciens. Presses universitaires de France.
Méthodologie
Avec la littérature administrative (ministère, inspections générales et territoriales, syndicats), cette recherche prend appui sur quatre ressources différentes :
- les dossiers administratifs des PLP d’une académie cible ont été dépouillés. Qu’ils soient définis comme "vivants" correspondant aux professeurs en activité (n= 1435) ou "morts" (personnels ayant pris leur retraite), ils ont permis de reconstruire les parcours professionnels de ces enseignants ;
- quatorze entretiens semi-directifs à questionner les biographies d’un corpus de PLP retenus sur le critère de disposer d’une représentativité de la pyramide des âges de la population totale des PLP ;
- vingt-deux participations observantes en établissement ont donné l’occasion d’observer les relations entre les différents membres de la communauté éducative au sein de lycées professionnels, mais également lycées polyvalents ;
- une enquête par questionnaire (n=1324) dans vingt académies de France complète le corpus.
L’analyse de ces matériaux a poursuivi l’objectif de déconstruire l’entité collective qu’est le corps des PLP pour y retrouver les individus (Noiriel, 2006).