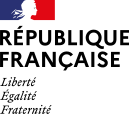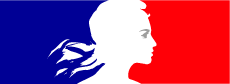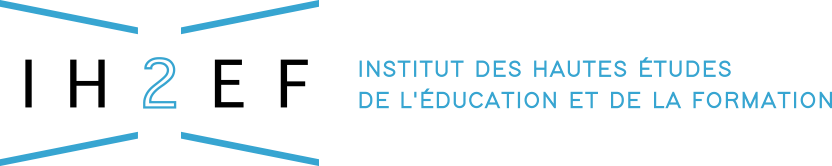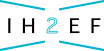Nicolas Moinet,
praticien-chercheur en intelligence économique
Professeur des universités à l’Institut de l'administration des entreprises (IAE) de Poitiers, Nicolas Moinet a été auditeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ devenu IHEMI) ainsi que de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN). Il a été réserviste opérationnel spécialiste dans l’armée de terre et est désormais réserviste citoyen dans la gendarmerie nationale sur les questions de sécurité économique. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles sur les questions de renseignement, de sécurité économique et d’influence.

Gagner la guerre avant la guerre
Cette expression, popularisée par le chef d'état-major des armées (CEMA) Thierry Burkhard, incarne la volonté d'imposer sa volonté à l'adversaire dès la phase de compétition, avant même qu'un affrontement létal ne se produise. Elle s'inspire de la philosophie de Sun Tzu, qui prône la victoire sans combattre.
Compétition-contestation-affrontement
Ce triptyque est la nouvelle grille de lecture stratégique proposée pour analyser et comprendre les conflits contemporains, remplaçant le continuum paix-crise-guerre. Il décrit un schéma systémique où les trois états interagissent continuellement, les acteurs restant les mêmes malgré les changements de phase.
Guerre hybride / Guerres atypiques
Ces termes désignent des conflits qui combinent des moyens conventionnels et non conventionnels, incluant des actions souterraines et indirectes. Elles caractérisent notamment la phase de contestation, où l'objectif n'est pas la destruction de l'adversaire mais sa dislocation par des attaques informationnelles ou des actions subversives.
Arsenalisation des réseaux (Weaponization)
Ce concept décrit l'utilisation stratégique des infrastructures mondiales et des réseaux ouverts, comme la fibre optique, les systèmes financiers ou les chaînes d'approvisionnement, comme des leviers géopolitiques ou des armes de guerre. Le contrôle de ces canaux devient un moyen d'influencer, de contrôler ou de perturber des sociétés et des économies.
Guerre dans le milieu social (GMS) / Political Warfare
Le Political Warfare, théorisé par George Kennan en 1948, est l'emploi de tous les moyens à la disposition d'une nation, à l'exception de la guerre militaire, pour atteindre ses objectifs, accroître son influence et affaiblir ses adversaires. La GMS, conceptualisée par le général français Jean Némo et détaillée par Raphaël Chauvancy, va plus loin en étant une architecture stratégique intégrée, indirecte et couverte, qui agit sur les mécanismes relationnels et cognitifs des compétiteurs pour les modeler à son avantage, en utilisant notamment la guerre de l'information et l'influence.
"Gagner la guerre avant la guerre" : un changement de paradigme stratégique
En février 2022, la sentence du chef d'état-major des armées (CEMA) Thierry Burkhard, "gagner la guerre avant la guerre", a résonné fortement, notamment après l'entrée de l'armée russe en Ukraine. Cette approche, peu habituelle pour le grand public, remet en question la perception traditionnelle de la guerre, en soulignant qu'elle ne concerne pas seulement l'armée, mais la nation tout entière et son esprit de défense. Ce concept s'éloigne du continuum paix-crise-guerre qui prévalait depuis la fin de la Guerre froide.
L'objectif de cette nouvelle vision est d'imposer sa volonté à l'adversaire dès la phase de compétition, avant que les menaces ne se concrétisent en affrontement létal. Cette philosophie puise ses racines dans les enseignements du stratège chinois Sun Tzu, qui, dès le VIe siècle avant notre ère, expliquait que le summum de l'art de la guerre est de vaincre sans combattre, en soumettant l'ennemi sans affrontement direct. Le général Burkhard a souligné l'échec initial de la Russie en Ukraine, n'ayant pas su imposer sa volonté dès la phase de compétition, ce qui a conduit à un affrontement coûteux et perdant-perdant.
Le triptyque compétition-contestation-affrontement et ses implications
Le passage du continuum paix-crise-guerre au triptyque compétition-contestation-affrontement représente un changement radical qui bouscule l'ordre établi et exige un apprentissage stratégique à l'échelle de la nation entière. Ce triptyque, dont la diffusion officielle a débuté en 2020. Le général Thierry Burkhard, alors chef d'état-major de l'armée de terre, propose un schéma systémique où les trois états interagissent continuellement, et où les acteurs demeurent les mêmes malgré les changements de phase. Les trois verbes "modeler, disloque et détruire" symbolisent chacun de ces états.
La compétition : modeler l'environnement
La phase de compétition est permanente. Elle s'exerce dans tous les domaines : économique, social, juridique, commercial et même culturel. Le niveau d'engagement militaire reste faible, conformément à la volonté des compétiteurs. L'objectif est d'envoyer des signaux pour dissuader les autres. Dans ce contexte, la stratégie de communication (Stratcom) et l'action dans les champs immatériels sont prépondérantes, car elles sont difficilement attribuables à leurs auteurs et impliquent un faible niveau d'engagement matériel.
La compétition est une forme de guerre avec nos compétiteurs. Dans cette phase, il s’agit de démontrer nos capacités et d’empêcher l’escalade jusqu’à la phase suivante. Le verbe associé à la compétition est "modeler". Il s'agit d'une action indirecte et couverte, qui ne vise ni à détruire ni à disloquer la cible, mais à lui inoculer insensiblement des grilles de lecture ou des critères de légitimité étrangers. L'ouvrage "L'Empire souterrain" des universitaires américains Henry Farrell et Abraham L. Newman illustre ce concept, décrivant comment les États-Unis ont transformé les réseaux ouverts (fibre optique, systèmes financiers, chaînes d'approvisionnement) en armes de guerre, un phénomène connu sous le nom d'arsenalisation des réseaux ("weaponization").
La contestation : disloquer l'adversaire
Dans la phase de contestation, un adversaire peut tester brutalement, cherchant à imposer un fait accompli. Il est alors crucial de réagir très vite et au bon niveau pour signaler que des lignes rouges sont franchies et que la détermination à en tirer les conséquences est crédible. Cette phase est qualifiée de "guerre juste avant la guerre". L'objectif est de contrer les adversaires ayant sous-estimé la détermination et d'éviter l'escalade vers l'affrontement.
Le verbe "disloquer" est celui de la contestation, domaine des guerres hybrides ou atypiques. Cet état est caractérisé par des actes indirects et souterrains. L'adversaire n'est plus considéré comme un ennemi à détruire, mais comme un interlocuteur dont on cherche la dislocation à courte ou moyenne échéance, en créant ou renforçant des dépendances. On observe un fort accroissement des attaques informationnelles dans cette phase. L'exemple de la stratégie russe en Afrique, visant à discréditer la France à travers des actions comme la manipulation du charnier de Gossi au Mali ou le financement de fondations ciblant les violences policières en France, illustre parfaitement ces "coups de billard à trois bandes" visant à ternir l'image et déstabiliser.
L'affrontement : détruire l'ennemi
La phase d'affrontement survient lorsque les manœuvres de découragement n'ont pas fonctionné et que la dialectique des volontés se concrétise par un engagement profond de moyens très importants. Chaque camp se mobilise et les alliances se nouent, au moins l'un des deux camps ayant estimé pouvoir l'emporter. Le verbe "détruire" se rapporte à cet état redouté. L'affrontement est une réponse cinétique extrême à un litige grave, limitée dans le temps et où la division se fait clairement entre amis et ennemis.
Cependant, être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin ; Sun Tzu enseignait que le summum est de soumettre l'ennemi sans croiser le fer. L'affrontement est coûteux, et la victoire n'est pas garantie et à quel prix. La guerre en Ukraine, avec ses interdépendances économiques et énergétiques, démontre les lourdes conséquences d'un affrontement prolongé. Néanmoins, même dans cette phase, les actions dans les champs immatériels restent cruciales pour empêcher l'adversaire de mobiliser toutes ses ressources pour se défendre.
L'importance des champs immatériels et des guerres non conventionnelles
Le général Burkhard a insisté sur le fait que l'action dans les champs immatériels constitue une rupture majeure dans la conduite de la guerre. Elle réunit dans une manœuvre unifiée les actions de renseignement, de cyber, de guerre électronique et d'influence. Ces actions débutent sous le seuil de l'engagement armé et sont généralement conçues pour être difficiles à attribuer à leurs auteurs.
Dans la sphère immatérielle, tous les coups sont permis pour affaiblir l’adversaire, le déstructurer, le diviser, le délégitimer et empêcher la prise rapide de décisions. Ces actions trouvent leur place dans chaque phase du cycle de conflictualité – compétition, contestation et affrontement – et sont essentielles pour acquérir la supériorité dans ces champs. La France a accusé un certain retard culturel dans ce type de conflit, ce qui a nécessité d'attendre la revue nationale stratégique (RNS) de 2022 pour que l'influence soit officiellement reconnue comme la sixième fonction stratégique.
Cette transformation est également illustrée par des concepts comme le Political Warfare défini par George Kennan, qui englobe toutes les actions non militaires pour atteindre des objectifs nationaux, allant de la propagande ouverte aux opérations psychologiques clandestines. La "guerre dans le milieu social" (GMS) va encore plus loin, étant une architecture stratégique intégrée, multi-domaines, sans limites géographiques ou temporelles et ne connaissant que des acteurs ou des cibles plutôt que des amis/ennemis. Elle agit sur la nature profonde de la cible, bloquant même la conception d'un acte plutôt que sa simple expression. Ses composantes principales sont la guerre de l'information et l'influence.
La doctrine chinoise de "La guerre hors limites", formulée par les colonels Qiao Liang et Wang Xiangsui, prolonge cette idée, en proposant d'élargir les actions de guerre à tous les domaines autres que le militaire – économiques, financiers, religieux, écologiques, etc. Pour eux, cela signifie que toutes les armes et techniques peuvent être utilisées à loisir, que les frontières entre guerre et non-guerre sont abolies, et que les lois mêmes de la guerre doivent être réécrites.
Un réveil stratégique national : implications et défis
Face à ces mutations, la pensée stratégique classique, trop axée sur la vision clausewitzienne de l'affrontement létal, est devenue caduque. Bien que l'armée demeure le fer de lance, la guerre moderne ne se limite plus au domaine militaire et un réveil stratégique urgent est nécessaire, impliquant l'ensemble de la Nation. Ce changement de paradigme est radical et ne va pas de soi, exigeant un apprentissage de la stratégie à tous les niveaux. Dès lors, l’éducation nationale est un pilier essentiel de l’engagement et de la résilience.
La guerre est un caméléon qui prend des formes nouvelles, couvertes et inattendues, et les citoyens se retrouvent partie prenante de ces nouveaux visages de la guerre, souvent sans le vouloir, ni même le savoir. Il est donc crucial que la vision stratégique du chef d'état-major des armées soit partagée par le plus grand nombre, en commençant par la représentation nationale. Au triptyque compétition-contestation-affrontement doit répondre un autre triptyque : puissance-influence-résilience. La politique de suprématie stratégique des États-Unis a longtemps pu être considérée comme un modèle à cet égard.
En somme, "gagner la guerre avant la guerre" implique une tension permanente, une vigilance constante pour ne pas être distancé par les compétiteurs, une capacité à parer la contestation et bien que l'objectif soit d'éviter l'affrontement, une préparation collective à le mener si nécessaire. Ce réveil stratégique est une condition sine qua non pour garantir la préparation opérationnelle et la supériorité militaire face aux défis géopolitiques actuels.
Bibliographie
- Chauvancy Raphaël, " Le Political Warfare ou la guerre par le milieu social (GMS) 1/2", Revue Défense Nationale, n°847, 2002/2 pp. 81-86.
- Chauvancy Raphaël, "Les nouveaux visages de la guerre", VA Éditions, 2023 pour la 2ème édition.
- Chauvancy Raphaël, "Vaincre sans violence". Manuel d’influence et de guerre de l’information, VA Éditions, 2025, p 17.
- Compte rendu n° 68 Session ordinaire de 2020-2021 — Audition, à huis clos, de M. le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major de l’armée de Terre sur l’actualisation de la Loi de programmation miliatire (LPM) 2019-2025.
- Farrell Henry & Newman Abraham, L’Empire souterrain : comment les États-Unis ont fait des réseaux mondiaux une arme de guerre, Éditions Odile Jacob, 2024.
- Jeangène Vilmer Jean-Baptiste, Le réveil stratégique. Essai sur la guerre permanente, Éditions du Seuil, 2024.
- Mainguy Daniel, Droit de la "guerre atypique", LGDJ, 2023.
- Moinet Nicolas, De la compétition à l’affrontement, VA Éditions, 2024.
- Qiao Liang et Wang Xiangsui, La guerre hors limites, Rivages poche, 2006, p. 39.
Cet article est extrait du dossier Intelligence économique.