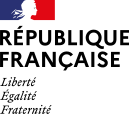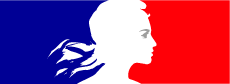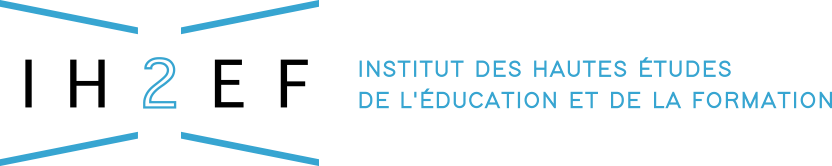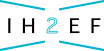Aziz Jellab,
Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche et docteur en sociologie et sciences de l’éducation.
Aziz Jellab est habilité à diriger des recherches, docteur en sociologie et en sciences de l’éducation. Il a mené plusieurs enquêtes et recherches sur différents segments du système éducatif français et plus particulièrement sur le lycée professionnel, ses élèves et ses enseignants. Sa thèse de doctorat en sciences de l’éducation soutenue en 2000 avait pour titre "Scolarité, rapport au(x) savoir(s) et à la socialisation professionnelle chez les élèves de CAP et de BEP" (thèse remaniée et publiée sous le titre Scolarité et rapport aux savoirs en lycée professionnel, PUF, 2001).
Par la suite, il a soutenu en 2007 une habilitation à diriger des recherches en sociologie portant sur la "Sociologie du lycée professionnel : l’expérience des élèves et des enseignants dans une institution en mutation" (habilitation parue sous le titre "Sociologie du lycée professionnel", Presses Universitaires du Mirail, 2009). Le pari de ses travaux est de proposer un dialogue fécond et vivant entre sociologie du lycée professionnel et pratiques pédagogiques repensées.

Le lycée professionnel au sein du paysage scolaire français : une histoire récente en profonde mutation
On compte 2100 lycées professionnels (y compris les lycées professionnels faisant partie d’un lycée polyvalent), 72 900 enseignants. Les LP accueillent et forment 621 600 élèves ainsi que 64 000 apprentis. Ils préparent à près de 550 diplômes et titres professionnels.
Un ordre de formation en mouvement pour s’adapter aux mutations du marché du travail
Il y a en effet une certaine profusion de réformes récentes que sont, après la généralisation en 2009 du baccalauréat professionnel préparé en 3 ans après le collège, la "transformation de la voie professionnelle" en 2018, mise en œuvre dès 20191 , puis la réforme de la voie professionnelle engagée à la rentrée 20232.
Cela tient à la spécificité même de la voie professionnelle qui n’est pas que scolaire, puisqu’elle forme aussi des apprentis, des adultes en formation continue, délivre des diplômes préparés de façon "classique" ou par validation des acquis de l’expérience (VAE).
Cet aspect protéiforme et en évolution régulière répond à des enjeux économiques qui conduisent à la rénovation des diplômes, de leur création ou de leur suppression.
La richesse de l’offre de diplomation en réponse aux enjeux socio-économiques
Deux diplômes majeurs sont préparés dans les LP et lycées polyvalents. Il s’agit du CAP, diplôme désormais centenaire et du baccalauréat professionnel crée en 19853.
Le CAP est un diplôme ayant historiquement désigné l’identité de l’enseignement professionnel4 et incarnant la reconnaissance tout autant par l’État que par les milieux patronaux des savoirs et savoir-faire dont il atteste. Le CAP a longtemps constitué le symbole princeps de l’excellence ouvrière.
Le baccalauréat professionnel5 a été créé pour répondre aux évolutions du marché du travail exigeant de nouvelles compétences ainsi qu’au projet politique national, mais aussi européen, d’une élévation des niveaux de qualification (avec le slogan "80% d’une classe d’âge au niveau bac").
Cette création ne fut pas sans controverses comme le montre bien Antoine Prost6. L’usage du terme "baccalauréat", qui consacre "l’ouvrier bachelier7" , ne correspondait pas aux attentes des différentes branches professionnelles mais faisait écho à des enjeux de valorisation de l’image de la voie professionnelle.
Mais les lycées professionnels, en réponse au besoin du marché du travail, proposent aussi des diplômes et qualifications professionnels préparés en LP inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)8.
Parmi les autres diplômes et qualifications préparés en lycée professionnel, il y a le brevet des métiers d’art (BMA), qui ne concerne qu’une minorité d’élèves ou d’apprentis. En revanche, les autres diplômes ou qualifications comme les mentions complémentaires - elles s’appelleront, au 1er janvier 2025, des "certificats de spécialisation" - ainsi que les formations complémentaires d’initiatives locales (FCIL) accueillent davantage de publics.
Les mentions complémentaires sont destinées en priorité aux élèves titulaires d’un CAP ou d’un baccalauréat professionnel et ont pour objectif de favoriser l’acquisition d’une qualification et de compétences dans un domaine spécifique. À la différence d’une MC qui est un diplôme national préparé dans le cadre d’un même champ professionnel, la formation complémentaire d’initiative locale (FCIL) constitue une spécialisation visant à acquérir des compétences en lien avec la demande locale des entreprises. D’une durée variant de 4 mois à un an, la FCIL est validée par une attestation ou un certificat d’établissement.
Le lycée professionnel et ses publics : une origine sociale majoritairement populaire, un secteur des services dominant, davantage de garçons que de filles et des spécialités genrées
Théâtre d’expériences plurielles, le LP reste aussi ce lieu de tous les paradoxes : à la réussite d’un grand nombre d’élèves fait face l’échec d’une partie de son public ; à la pacification des relations entre ce public et les enseignants s’opposent des conduites conflictuelles, voire violentes entre élèves et entre ceux-ci et des enseignants.
Une origine sociale plus populaire que la réalité socio-économique
Les élèves de lycée professionnel appartiennent majoritairement aux milieux ouvriers, employés et inactifs. En 2022, sur les 102 370 élèves de CAP, 6,7% proviennent de milieu artisans, commerçants, chefs d'entreprise, 3,9% de professions libérales et cadres, 8% de professions intermédiaires, 16,8% de milieu employés, 32,4% de milieu ouvriers et 29% de milieu inactifs. Sur les 510 611 élèves préparant un baccalauréat professionnel, ils sont 9,2% à provenir de milieu artisans, commerçants, chefs d'entreprise, 7,4% de professions libérales et cadres, 11,3% de professions intermédiaires, 19,5% de milieu employés, 32,5% de milieu ouvriers et 16,1% de milieu inactifs. À titre de comparaison, en lycée général et technologique, la part des élèves issus de milieu employés et ouvriers est respectivement de 16,5 et 17,9% lorsque celle des professions libérales et cadres, artisans, commerçants et chefs d’entreprise est respectivement de 26,8 et 10,7%9.
Une répartition genrée selon les spécialités
Filles et garçons se répartissent de manière inégale selon les spécialités : les filles représentent 39,4% des élèves de CAP et de bac pro publics. Mais la répartition des filles et des garçons reste très marquée selon les spécialités de formation. Ainsi, en CAP "bâtiment : construction et couverture" (public et privé), la part des filles est de 2,7%, et de 5,1% en bac pro. Dans la spécialité "finitions" du bâtiment, cette part passe à 8% en CAP et à 25,3% en bac pro. En structures métalliques, le pourcentage des garçons reste aussi très élevé puisque les filles ne constituent que 3,8% en CAP et 4,4 en bac pro. De fait, dans les domaines de la production, et hormis les spécialités du textile, habillement, cuir et peau où elles sont majoritaires, les filles ne représentent que 19,7% des effectifs totaux de CAP et 13,7% des effectifs de bacs pro. En CAP "commerce vente", elles sont 52,7%, et 52,4% en bac pro. Ce pourcentage passe respectivement à 86,4% et à 96,9% en coiffure et esthétique ; il est de 73,1% en CAP accueil, hôtellerie et tourisme, mais chute à 42,5 dans la filière bac pro. Dans toutes les spécialités des services confondues, les filles représentent 59,5 en CAP et 61% en bac pro.
Le devenir des sortants des formations professionnelles conduit à des constats encore mitigés
Sur 100 élèves entrant en seconde professionnelle, 39 entrent dans la vie active après le baccalauréat (dont 10 à l’issue d’une formation complémentaire), 28 entreprennent une formation dans l’enseignement supérieur, mais seulement 16 valideront un BTS, quand 33 quitteront le LP sans baccalauréat ou diplôme équivalent.
Une poursuite d’études dans le supérieur en demi-teinte
La création du baccalauréat professionnel, le passage de 4 à 3 années d’études pour le valider et le rajeunissement relatif10 des publics scolaires - du fait de la baisse du taux de redoublement en collège - ont modifié partiellement la donne : désormais, la majorité des élèves entrant en seconde professionnelle aspirent à poursuivre des études à l’issue du baccalauréat, et l’effet d’appel des STS, bien réel, a conduit à ce que la part des bacheliers professionnels préparant un BTS passe de 31% en 2011 à 42,2% en 202111.
L’enseignement supérieur court - principalement les études en BTS - est devenu attractif pour les élèves de la voie professionnelle12.
Sur les 186 200 néo-bacheliers professionnels, moins de la moitié a émis des vœux sur Parcoursup - environ 82 000 - et à peine 60 000, soit un tiers de l’ensemble des diplômés a accepté une proposition13. Cette aspiration à la poursuite d’études n’est pas sans soulever des interrogations. En effet, dès lors que la seule perspective permettant de valoriser la voie professionnelle devient la poursuite des études, le risque d’une déqualification du diplôme - du bac pro en l’occurrence - est patent14, dans la mesure où l’entrée sur le marché du travail peut apparaître aux employeurs comme un signal d’inaptitude à prolonger sa formation dans l’enseignement supérieur. Le fait que la voie professionnelle accueille des publics issus majoritairement de milieu populaire interroge sur les missions revenant à cet ordre de formation.
Et la donne pourrait bien connaître une reconfiguration si l’on se place au plan de l’enseignement professionnel supérieur long (notamment pour les niveaux II et I, licence professionnelle et Master notamment) car toutes les enquêtes mettent en évidence une diminution progressive du nombre d’étudiants issus de milieu populaire à mesure que s’allonge la durée des cursus. "Planche de salut15" , l’enseignement professionnel a assuré à plusieurs générations une ascension scolaire et sociale, mais celle-ci s’est fortement ralentie quand elle n’a pas décliné, dans un contexte de déclassement social.
Une insertion professionnelle qui progresse mais qui continue à poser des difficultés
Les études inserjeunes publiées par direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) en décembre 2023 mettent en évidence une amélioration du niveau d’insertion des diplômés de formation professionnelles. Ainsi, 50% des lycéens professionnels sont en emploi salarié dans le secteur privé en juillet 2022. Leur insertion s’est améliorée par rapport à la situation en janvier 2022, avec une hausse du taux d’emploi de 9 points.
Néanmoins ces chiffres cachent des réalités contrastées.
- L’insertion professionnelle diffère selon les domaines de spécialité de formation.
Tous niveaux de formation confondus, les spécialités "énergie, chimie, métallurgie", "coiffure esthétique" et "technologies industrielles" offrent une bonne insertion sur le marché du travail. A contrario, l’insertion est plus faible pour la spécialité "électricité, électronique", quel que soit le niveau de formation (26 %pour les CAP, 39 % pour les baccalauréats professionnels et 59 % pour les BTS). - Une insertion professionnelle différenciée selon l’origine sociale.
Le taux d’emploi des jeunes dont le représentant légal est "artisan, commerçant ou chef d’entreprise" ou "profession intermédiaire" ou "cadre-profession intellectuelle supérieure" est plus élevé que celui de l’ensemble (53% contre 48%). À l’inverse, parmi les 26% de sortants dont le représentant légal est sans activité, seuls 40% ont trouvé un emploi salarié 6 mois après la sortie du système scolaire. - Une insertion qui démontre une certaine fragilité des situations.
L’emploi à durée indéterminée (CDI) concerne 39% des lycéens en emploi salarié 6 mois après leur sortie d’études. Par ailleurs, 36% sont en contrat à durée déterminée (CDD), 15% en intérim, 2% en contrat de professionnalisation et 8% sur d’autres types de contrats. L’intérim est nettement plus représenté chez les jeunes hommes, tandis que les jeunes femmes sont plus souvent en CDD ou disposent, dans une moindre mesure, d’un autre type de contrat. Les hommes sont en effet majoritaires dans les formations de la production (86%). Or, ces formations débouchent vers des secteurs où les contrats temporaires prennent souvent la forme d’intérim. Les femmes sont, quant à elles, plus présentes dans les services (59%) qui recourent plus fréquemment aux CDD.
S’il est parfaitement légitime de se réjouir de ces progrès il ne faut cependant pas oublier que la bataille de la lutte contre le décrochage reste à gagner pour de nombreux élèves qui entrent en lycée professionnel, puisque sur 100 élèves qui rentrent en seconde professionnelle, un tiers risque de décrocher, sans bac ou équivalent.
Conclusion
La réforme engagée en 2023 qui requestionne le fonctionnement des lycées professionnels poursuit l’objectif de faire du lycée professionnel une voie de réussite, choisie par les élèves et leurs familles, reconnue par la société et les entreprises et qui offre de meilleures conditions d’exercice du métier aux enseignants. Les lycées professionnels ont su relever de nombreux défis. Des progrès restent encore à accomplir en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de poursuites d’études pour garantir une meilleure insertion professionnelle de ces lycéens.
________________________________________________________________________