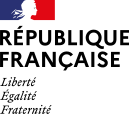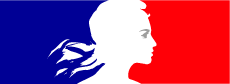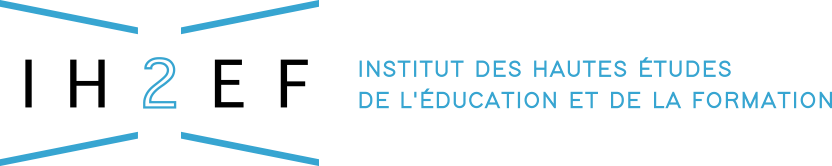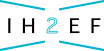Qu’est-ce qu’un projet ?
Qu’est-ce qu’un projet ?
Au Moyen Âge, le terme de projet, plus précisément le vieux français "pourjet" désignait ce qui est jeté devant, par exemple un balcon devant un édifice ou un jardin devant une maison ; de connotation spatiale, ce projet s’est temporalisé après la Renaissance, pour désigner le temps devant soi, celui d’un avenir désiré. À propos de cet avenir désiré qu’est le projet, nous prenons conscience que sémantiquement l’avenir n’est pas le futur ; le futur nous échappe car il signifie ce qui doit être obligatoirement, malgré nous. Par exemple le changement de saison, l’alternance jour-nuit, notre avancée en âge appartiennent au futur car nous n’y pouvons rien. Le projet avec ses incertitudes ne relève donc pas du futur mais bien de l’avenir de par les possibles que ce dernier offre et que nous pouvons saisir pour les aménager : un départ en vacances vers telle ou telle destination, l’inscription à une session de formation recommandée, l’achat d’une maison dans un endroit attractif, etc. Ainsi, pour élaborer un projet dans ce monde de possibles porteurs d’avenir, nous allons choisir ce possible qui retient notre attention.
Le même terme de projet peut désigner un avenir désiré au niveau individuel, par exemple le projet d’orientation d’un lycéen comme un avenir désiré au niveau collectif, ainsi un projet d’entreprise ou d’établissement. C’est surtout avec l’avènement de l’ère postmoderne des années 1970-1980 que l’usage du projet va se démocratiser et s’intensifier, aussi bien en ce qui concerne les projets individuels que les projets collectifs : le management ou la gestion par projet fut l’une des figures du projet les plus en vogue dans ces années-là. Le projet évènementiel reste l’une des plus récentes figures de projet, créée au début des années 2000.
Ce qui fait l’originalité de la démarche par projet c’est son organisation en deux temps inscrits dans les deux syllabes de "pro" et de "jet" :
- le temps du "pro" est celui de l’anticipation. Il comprend plusieurs étapes : l’analyse de la situation actuelle (diagnostic), l’élaboration de différents scénarios envisageables à court terme en fonction du contexte et des intentions de son auteur, le choix du scénario retenu, puis sa validation par l’instance compétente, qu’elle soit une autorité formelle (commanditaire) ou un acteur plus informel de l’environnement ;
- le temps du "jet" concerne la réalisation, intégrant lui aussi plusieurs étapes : planification des phases de la réalisation, inventaire des moyens disponibles ou à acquérir, mise en œuvre de la réalisation, évaluation.
Autre caractéristique essentielle concernant le projet : celui-ci est inséparable de son auteur qui l’anticipe et le réalise. Cet auteur peut donc se considérer comme le responsable de son projet dans le double travail réalisé autour de sa conception et de sa réalisation. Mais cet auteur du projet est aussi tenu responsable par son environnement social de ce qu’il a conçu et produit, contrairement aux autres anticipations opératoires comme le plan, le but ou l’objectif, qui, elles, ne sont, la plupart du temps, pas personnalisées. C’est donc l’auteur-créateur, individuel ou collectif qui va construire son projet en s’entourant d’acteurs coopératifs.
 Comment définiriez-vous le rôle de chef de projet ?
Comment définiriez-vous le rôle de chef de projet ?
Si l’auteur d’un projet quelconque n’a pas en règle générale de commanditaire bien défini, autre que son propre environnement de vie ou de travail, le chef de projet, au contraire en ce qui le concerne, a été nommé, désigné, voire élu par un commanditaire, par exemple un chef d’entreprise ou d’établissement. Ce chef de projet se situe au regard d’un double espace de liberté :
- le premier concerne la situation actuelle à diagnostiquer avec ses contraintes mais aussi ses opportunités ;
- le second est l’espace de liberté qu’il va se donner pour créer son propre projet à travers ses propres intentions, mais aussi les initiatives qu’il va prendre au regard de la situation face à laquelle il se trouve, notamment l’espace de liberté que lui consent son commanditaire.
Dans le cadre du management par projet, le chef de projet reçoit une mission déterminée de son commanditaire ; ce chef de projet constitue son équipe-projet, soit interne à l’entreprise, soit extérieure, soit encore mixte et confie à cette équipe le soin de gérer avec lui un changement horizontal dans l’entreprise, suite à la commande qui lui est faite. Ce changement horizontal sera donc défini et introduit par le chef de projet et son équipe par négociation et expérimentation avec les différents services concernés de l’entreprise qui deviennent autant de parties-prenantes.
Quelles que soient les situations, la principale qualité ou compétence que le commanditaire attend du chef de projet concerne l’attention que ce dernier va porter à la commande en premier lieu, puis à tous les acteurs parties prenantes au projet. Ce chef de projet sera soucieux de promouvoir ce qui caractérise la créativité et la singularité de son projet au regard de la situation. Pour ce faire, il devra être soucieux de préserver et, si possible, de développer un espace relationnel et coopératif avec les acteurs de l’équipe-projet, internes et/ou externes à l’organisation.
 Pour vous, quelle est la part d'autonomie et de responsabilité qui incombe au chef de projet ?
Pour vous, quelle est la part d'autonomie et de responsabilité qui incombe au chef de projet ?
La marge de manœuvre est très variable pour un chef de projet, au regard de la situation de départ liée à l’entreprise ou l’établissement dans lequel il intervient. Son autonomie se définit au regard de ce qu’il négocie avec la direction de l’organisation commanditaire et de ce qu’il convient avec les parties prenantes du projet, d’abord les membres de cette équipe, ensuite les partenaires extérieurs. Cette autonomie essentielle sera évidemment tributaire du style adopté par le chef de projet lui-même, du plus ou moins coopératif au plus ou moins autoritaire vis-à-vis des acteurs qu’on lui a confiés ou qu’il a recrutés : une démarche par projet se reconnaîtra bien entendu si l’autoritaire est maîtrisé au profit du coopératif. La singularité liée à la démarche de tout projet doit apprendre à composer, voire à s’enrichir grâce à la pluralité des caractéristiques de son environnement à découvrir.
Quel qu’il soit, un management par projet à travers l’aventure créatrice qu’il promeut gagnera à être organisé en reléguant dans les échanges l’ordre imposé au profit de la négociation privilégiée. Aussi, l’autonomie de l’équipe-projet doit être négociée dès la mise en place du projet pour que les responsables hiérarchiques qui avoisinent l’équipe-projet soient soucieux d’aménager autour de cette équipe suffisamment d'espaces de liberté, associant le cas échéant des salariés extérieurs à l’équipe-projet mais appartenant à l’organisation commanditaire. De ce fait la philosophie participative du management par projet valorise l’horizontalité dans les relations au profit d’une innovation à mettre en place.
Mais l’autonomie dans la gestion par projet ne saurait dissoudre la responsabilité qui incombe au chef de projet. Ce dernier se porte garant du résultat de la démarche qu’il régule mais aussi des contextes d'ambiance dans lesquels s’est déroulé la réalisation du projet. Cela suppose pour toutes les parties prenantes d’un projet de s’entendre sur des règles négociées de la mise en œuvre d’un projet et de son déroulement, sachant que la responsabilité au sein d’un projet est celle du chef de projet, qui gagnerait souvent à être dénommé auteur du projet, un auteur qui intègre ces trois caractéristiques inhérentes à tout projet de créativité, de singularité et de responsabilité.
Tout ce qui précède n’exclut évidemment pas que le déroulement d’un projet ne puisse passer par des difficultés, se concrétisant le cas échéant dans une crise. Celle-ci va alors impliquer la mise en œuvre d’un audit interne à la diligence du chef de projet ou si la crise remet en cause trop d’enjeux dans la démarche de projet, un audit externe sous la responsabilité de l’organisme commanditaire : dans l’un ou l’autre cas, surmonter la crise se fera au prix d’une transformation du projet, à négocier.
 Est-ce que l’accompagnement d’un projet mobilise les mêmes compétences que celles d’un chef de projet ?
Est-ce que l’accompagnement d’un projet mobilise les mêmes compétences que celles d’un chef de projet ?
Lorsque j'accompagne un projet, je ne suis pas du tout chef de projet : je suis conseiller. Je conseille le chef-projet, le responsable du projet qu’est l’auteur ; de ce fait, je ne suis pas impliqué dans le déroulement immédiat du projet car je prends du recul pour me faire un diagnostic privé voire un audit sur la situation momentanée. Je me mets donc en recul par rapport à la situation-projet. Dans sa conception ou sa réalisation, en tant qu’accompagnant, je n'ai pas de pouvoir de fait sur la conduite du projet autre qu’un pouvoir informel à partir de tout ce que j’ai pu observer, alors que quand je suis chef de projet, j'ai un pouvoir effectif sur la conduite du projet à travers un pouvoir d’agir sur une situation et sur les acteurs impliqués.
Quand j'accompagne, j'essaie d'être attentif à la situation, à ce que j’observe, à ce qu'on me dit de façon formelle ou informelle. Je rebondis par rapport à la situation que l'on me décrit en tant que témoin de cette situation. Je le fais remonter au chef de projet et aux acteurs coopératifs.
J'accompagne donc, par ma présence, les moments de rencontre officiels préprogrammés mais aussi des moments de rencontre informels hors calendrier qui se présentent à l’improviste. J’aide les parties prenantes au projet à opérer un recul nécessaire par rapport à la situation du moment et à relativiser, mais non pas ignorer les différentes observations faites par les uns et les autres.
En termes de responsabilité, l’accompagnateur que je suis n’a pas de responsabilité directe sur le projet, mais il est responsable de sa fonction de témoin, de ce qu'il peut dire ou ne pas dire au chef de projet et à son entourage. Pour récapituler, l’accompagnateur a une responsabilité indirecte sur le projet concerné dans la façon par laquelle il va comprendre la situation et le faire savoir, mais il n’a pas du tout les mêmes compétences qu’un chef de projet : si le premier se fait plus distancié, le second se veut plus impliqué.
 Pour conclure cet entretien, quels conseils donneriez-vous aux cadres de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur pour développer leur autonomie et leur responsabilisation dans le contexte d’un management de projet ?
Pour conclure cet entretien, quels conseils donneriez-vous aux cadres de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur pour développer leur autonomie et leur responsabilisation dans le contexte d’un management de projet ?
L’action du chef de projet, telle qu’elle a été appréhendée ci-dessus s’inscrit dans une démarche de management par projet, encore appelée dans un langage francisé "gestion de projet". Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, les managements par projet existent déjà au niveau des institutions scolaires. Sont-ils suffisants ? Passons-nous à côté d’interrogations auxquelles ces managements seraient susceptibles de répondre ? Certes, on pourrait se questionner sur des managements de projets à mettre en place concernant des problèmes de société perçus au niveau d’un établissement ou faire porter ce questionnement à plusieurs établissements, en restant dans le contexte français ou encore en l’étendant au contexte francophone, voire international. Par exemple, aujourd’hui, on pourrait évoquer trois figures de projet d’actualité qui ne peuvent laisser indifférents au niveau local, national et international :
- l’usage du portable à l’école, en vue de quels résultats ?
- La dissipation de la violence scolaire, à quelles conditions ?
- Le monde professionnel qui entoure un établissement scolaire, comment le découvrir ?
Solliciter une communauté scolaire pour qu’elle réponde à l’une ou l’autre de ces trois thématiques ne laisserait pas sans questionnement autonomie et responsabilisation des parties prenantes d’un établissement scolaire.
Une autre façon d’appréhender la pertinence du management par projet à l’école est de réfléchir, avec les acteurs éducatifs impliqués, sur une démarche de projet leur permettant d’appréhender les problèmes qu’ils évoquent souvent les concernant pour qu’ils puissent trouver entre eux une solution : personnels administratifs, enseignants dans leur diversité, enseignants appartenant à la même discipline, parents d’élèves du 1er degré, parents d’élèves du 2d degré-collège, parents d’élèves du 2nd degré-lycée.
Il est possible aussi qu’un établissement scolaire, collège ou lycée, suscite un management par projet rassemblant une pluralité d’acteurs gravitant dans et autour de l’établissement pour qu’il repense son propre projet d’établissement vieillissant, donc devenu formel, en le dégageant de son formalisme routinier pour qu’il appréhende des enjeux actuels auxquels il se trouve confronté. Dans ce cas-là, le chef d’établissement, le cas échéant appuyé sur son conseil ad hoc jouera son rôle de commanditaire.
Cet entretien est extrait du dossier Autonomie et responsabilité des cadres.